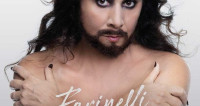Le Postillon de Lonjumeau mène son attelage à l’Opéra de Rouen
36 ans après 1836 et la création du Postillon de Lonjumeau d’Adolphe Adam, Victor Hugo se remémore ce (déjà) célèbre personnage dans Les Misérables (Tome V, Livre VI, Chapitre I). Ce passage du fameux écrivain français se référant à l’accoutrement somptueux du postillon (« veste bleue aux retroussis rouges et aux boutons grelots », etc.) est ici repris à la lettre par l’équipe créative de Michel Fau (costumes d’Emmanuel Charles). Le procédé s’aligne avec l’idée générale de la conception scénique qui semble relever de la restitution historico-artistique du théâtre XVIIIe siècle. Le côté superficiel et artificiel est suramplifié avec le choix des décors floraux multicolores (des grands panneaux) et par le biais des artifices d’un parler déclamatif (dans les dialogues non-chantés). Le mouvement scénique est réduit au profit du gestuel, alors que l’espace est en majeure partie limité par un rideau frontal qui diminue la manœuvre spatiale, mais rapproche les artistes du public.
Outre le rapprochement intimiste, peut-être désirable pour des fins purement dramatiques, cette stratégie pourrait retrouver sa raison d'être dans le volume vocal fort restreint de cette distribution. Dès la première scène où le couple Chapelou/Madeleine célèbre ses noces avec les villageois (tout en étant sur un grand gâteau), les solistes peinent à dépasser la fosse depuis le fond du plateau, idem pour les choristes (pourtant plus proches de l’auditoire).
Philippe Talbot, dans le rôle-titre, offre une prestation engagée, tant sur le plan vocal que théâtral. Il dévoile un timbre doux et lumineux qui prend sa mesure dans les exploits du domaine supérieur de sa tessiture. Dans le fameux air "Mes amis, écoutez l’histoire » (Rondo du postillon) où Chapelou prévoit son destin d’homme abandonnant le village pour joindre le service royal, Talbot relève le défi en montant vers les suraigus : le contre-ut et contre-ré sont tirés par une force supplémentaire, lui assurant d'arriver à bon port dans l’extrémité de la ligne vocale. Si son volume mincit en descendant vers les graves et dans les duos avec sa partenaire soprano Madeleine, il manifeste pourtant une musicalité prononcée dans les extraits piani à l’accompagnement léger. La sonorité de son ténor est chaleureuse et ronde, quelque peu nasale mais au profit d’une prononciation soignée du français (tant le chanter que le parler).

Hélène Carpentier dans le rôle de Madeleine/Madame de Latour est une soprano à la voix élastique qui livre sans grandes difficultés des vocalises rapides et techniquement exigeantes, préservant la justesse du ton et la longueur du souffle. Par ailleurs, ses phrases sont colorées d’un vibrato (parfois démesuré) et d'un timbre à la fois clair et métallique. La souplesse de sa voix légère trouve son épanouissement dans les aigus, tandis que les notes en fins de lignes souffrent d’un peu d'acide. Même si la force vocale n’est pas son premier atout, la soprano assied toutefois une solide voix poitrinée. Le jeu d’acteur de ce double rôle est plutôt convaincu et la prononciation théâtrale à la XVIIIe siècle visiblement travaillée, ce qui lui vaut (entre autres) les plus grands applaudissements à l’issue de la représentation.

Dans les rôles seconds, le baryton Lionel Peintre en Marquis de Corcy joue un personnage qui mêle la méchanceté (palpable dans la voix) et le caractère grotesque. Bien que son chant menaçant ne soit pas de tradition opératique, son intonation est correcte et sans glissements vers des domaines brumeux de la tonalité. Samuel Namotte en Biju/Alcindor est un jeune baryton dont la prestation remporte son succès sur le plan de l’interprétation dramatique (notamment le comique) du personnage plutôt que par son chant. Il se heurte à des problèmes rythmiques qui le désynchronisent de l’orchestre, alors que la justesse de son instrument vibré est tenue. Julien Clément pose un baryton bas à l’assise charnue et foncée, figurant le personnage bouffon d’un faux prêtre. Quant au comédien Yannis Ezziadi en Rose, son jeu s'éloigne de l’aspect grotesque qu'offrait Michel Fau mais s'il ne peut jouer autant de son physique, il entre dans la peau du personnage travesti.
Le Postillon de Lonjumeau illumine la soirée de ses couleurs et du fameux contre ré à @Rouen ! pic.twitter.com/pEkJzqGCjr
— Opéra Rouen Normandie (@operaderouen) 13 décembre 2019
Sébastien Rouland dirige l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie avec un enthousiasme principalement porté par les cordes. L'ensemble se distingue par un son clair et expressif, notamment chez la section des bois au début du troisième acte, d’abord dans la douceâtre sonorité du hautbois puis la maîtrise de clarinettiste (qui se fait même applaudir à la fin du prélude par ses confrères de la fosse). La difficulté pour le chef d’orchestre vient plutôt de la coordination entre tous les acteurs musicaux, suscitant de sérieux décalages rythmiques avec le chœur masculin, mais aussi avec quelques solistes.
Une fois le rideau tombé, le public de l’Opéra de Rouen Normandie accorde un accueil réservé aux artistes, malgré quelques Bravo !