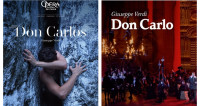La Favorite à Marseille, Donizetti à la faveur du concert
L’œuvre, créée à l’Opéra national de Paris le 2 décembre 1840, est chantée dans sa version originale, en français, sur un livret d’Alphonse Royer et Gustave Vaëz, d’après le drame de Baculard d’Arnaud, Les Amants malheureux ou le Comte de Comminges. Elle n’a pas été donnée à l’Opéra de Marseille depuis une cinquantaine d’année (1968). Le compositeur livre, dans le processus même de remaniement dont l’œuvre est l’aboutissement, la représentation qu’il se fait des attentes du public parisien, habitué au genre du « grand opéra » codifié par Halévy et Meyerbeer : tragique réaliste et romantique, virtuosité toujours nécessaire d’écriture et d’interprétation.
L’action se rêve, grâce aux didascalies des surtitres, à la cour et au cloître d’un moyen-âge andalou, entre opulence et ascèse. Alphonse de Castille, sa maîtresse « favorite » malgré elle, Léonor, ainsi qu’un jeune novice, Fernand, sont les agents dramatiques d’une triple rivalité. Elle fait s’opposer, côté individus, le roi à son rival, côté institutions, le pouvoir temporel au pouvoir spirituel, côté sentiments, l’amour humain à l’amour divin. L’absence de décor et de mise en scène, paradoxalement, donne une cohérence et une densité à une intrigue aux articulations parfois fragiles. Un écrin d’enchantement sensible souligne ce que la musique doit aux corps des musiciens, dans l’extériorisation comme dans l’introspection. En dépit de la fixité du concert, rien n’est statique. Un plateau d’une distribution choisie de solistes se tient, au fil d’allées et venues, à l’avant-scène, sur la même ligne que le chef, visiblement dans son élément naturel.

Clémentine Margaine - La Favorite version concert (© Christian Dresse)
Léonor de Guzmán, la maîtresse du roi de Castille, trouve en Clémentine Margaine sa grande mezzo-soprano. La présence vocale est immédiate. La voix est ample, bien projetée et dosée, dans l’ensemble des registres. Le souffle en pétrit une pâte de couleurs somptueusement moirées. Le phrasé est naturel et le chant sort tout seul, avec une facilité déconcertante qui lui confère une valeur musico-thérapeutique. La chanteuse, en actrice-studio, donne à l’être central du drame une interprétation profonde, sensible, intensément orientée et engagée en direction de ses partenaires, malgré les frontières des pupitres, comme pour mieux exprimer ses tiraillements. En elle est concentrée une grandeur morale qui fait défaut aux deux hommes de sa vie. Décidée à faire dépendre sa vie de la sincérité, et sa mort du pardon, elle se montre magnifique de responsabilité. Dans ce drame de l’honneur, le pouvoir véritable est celui que les êtres sont capables d’exercer sur eux-mêmes.
Fernand requiert du ténor sicilien Paolo Fanale toute l’ardeur et l’endurance natives d’un jeune homme souriant et heureux à la scène comme à la ville. Il est ce novice qui, par amour de Léonor dont il ignore la situation, renonce à ses vœux, pour trouver courageusement la gloire dans le monde, et se montrer digne de son rang. Un legato continu, en dialogue avec le texte, dessine chaque mot de sa couleur significative. Il apporte son soutien à une diction française qui ouvre un peu trop les « e » et enjambe quelques consonnes. Le premier acte éprouve en permanence ses aigus, légèrement tendus au début, mais qui se colorent d’un pigment d’intériorité méditative, jusqu’à son air de l'Acte IV : « Ange si pur ». Vient « La douleur tue » : il y dépose et concentre toute son humanité et le sens final du drame. La voix se chauffe peu à peu pour développer un phrasé vibrant qui transporte l’auditeur jusqu’à lui. L’absence de mise en scène produit une relation immédiate, spontanée, entre le chanteur et la salle, qui le met à l’abri de toute tentation de cabotinage. Le jeune ténor parle comme il chante… délicieusement et avec délice.

Jean-François Lapointe - La Favorite version concert (© Christian Dresse)
Le roi Alphonse XI de Castille est assuré par l’indispensable baryton canadien Jean-François Lapointe. Il est à la mesure vocale de sa partenaire favorite. Il y greffe la dimension institutionnelle de son personnage : autorité, charisme, puissance. Son maintien vertical, alors que son personnage est également tiraillé entre plaisir et pouvoir, annonce la bonne opération stratégique à laquelle il se livrera en réponse à la menace de l’Église. Le chanteur projette impeccablement une ligne de chant sombre et chaude en couleur, suave et violente en dynamique, limpide et ciselée en diction. Il sait faire émerger le silence absolu : « Non, rien par moi n’est regretté », carapace sonore le tenant finalement à distance de sa belle (« chaste / stérile flamme »).

Paolo Fanale et Nicolas Courjal - La Favorite version concert (© Christian Dresse)
Balthazar est tenu par le chanteur basse français Nicolas Courjal. L’absence de mise en scène dépoussière ici le rôle et lui donne sa véritable grandeur. La silhouette anguleuse et noire du soliste, reflet vivant d’un personnage du Greco, incarne la parole des cieux, paroles de condamnation, de bannissement, d’excommunication : « Redoutez la fureur d’un Dieu terrible et sage ». Il l’incarne moins comme un homme tiraillé qu’un homme double, frère protecteur auprès de Fernand et émissaire du Pape auprès du Roi. Là réside sa part d’humanité, que porte jusqu’à nos oreilles un timbre sombre mais plein, jusque dans la descente vers les abîmes, et dont il sait prolonger la part impressionnante en le mixant avec les cuivres.
Inès, la confidente, est l’autre personnage féminin. La soprano nîmoise Jennifer Michel confère à ce rôle de femme, empêchée de délivrer le message de vérité de Léonor, une assiette dramatique faite d’attention et de sensibilité. La ligne claire de son instrument parvient à filer vers les cimes des coloratures et des ensembles, en évitant l’écueil décoratif. L’autre confident à la voix claire est le Don Gaspar du ténor Loïc Félix. Si l’une est empêchée dans sa parole de vérité, l’autre, en exact inverse, ne l’est pas, et dévoile à Fernand que sa promise est la favorite du Roi. Sa diction, impeccable, confère un poli brillant au léger métal de ses aigus.

Jennifer Michel, Clémentine Margaine et Paolo Fanale - La Favorite version concert (© Christian Dresse)
La direction musicale de Paolo Arrivabeni, rapide et énergique, apporte une tenue homogène au puzzle d’emprunts que Donizetti fait à lui-même dans cette œuvre. Elle est traversée par trois essentielles signatures : le temps lisse des romances mélodiques, le temps strié d’une constante pulsation, le temps arrêté des ensembles finaux. Le chef, aux épaules bien dessinées, dirige la phalange marseillaise et les solistes avec la sensualité de ses sourires, de ses regards et de ses flexions. Il sait se tenir sous le son, comme pour mieux le déployer, à l’autre extrémité de sa baguette frémissante d’énergie communicative, l’étoffe d’écriture, depuis le piano subito jusqu’aux plus amples dimensions symphoniques. Ses signes microscopiques et complices d’encouragement à accomplir la musique, en direction des protagonistes de la scène, apportent une lumière sans rutilance aux grands ensembles avec chœurs. Ces derniers interviennent, depuis l’arrière-scène, avec une constante homogénéité et une suavité, y compris dans la puissance. Ils tiennent intégralement leur rang dans les grandes clôtures d’émotion de l’opéra (« de honte et d’effroi » à l'Acte III notamment), comme dans les passages plus sporadiques et sotto voce ("sous la voix", à mi-voix) qui l’émaillent.
Le public, finalement émerveillé par le beau chant d’opéra de cette soirée de première, réserve une standing ovation aux interprètes, comme à l’œuvre, jamais mieux servis peut-être que par la solution concertante.